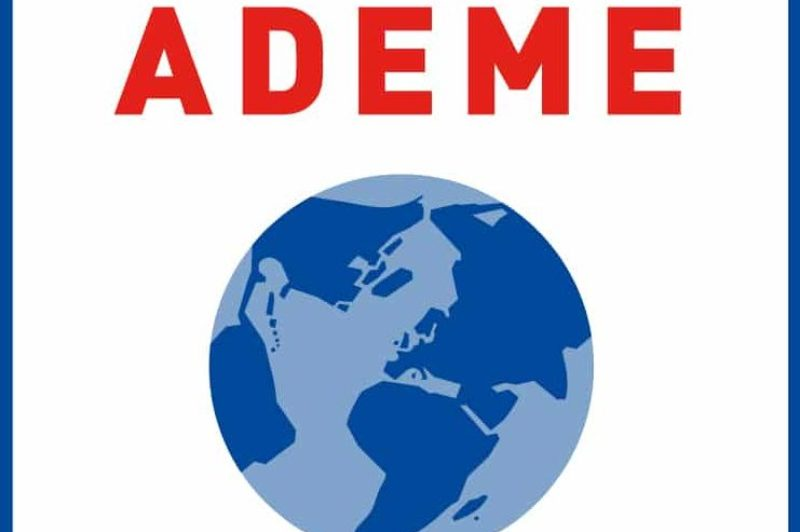Si les économistes Christian Gollier et Jean-Charles Hourcade s’accordent sur la nécessité du calcul coût bénéfice pour chaque politique de transition, ils divergent sur les rôles respectifs du marché et de l’Etat. Entretien.
Propos recueillis par Antoine Reverchon – Publié le 29 novembre 2019
Entretien. Christian Gollier est économiste, directeur général de l’Ecole d’économie de Toulouse, qu’il a confondée avec Jean Tirole en 2007. Il a été l’un des lead authors (auteurs) du rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en 2007, et président élu de l’Association européenne des économistes de l’environnement en 2018. Il est notamment l’auteur de Le Climat après la fin du mois (PUF, 367 pages, 19 euros). Jean-Charles Hourcade est économiste, directeur de recherche au CNRS et directeur d’étude à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il a dirigé le Centre international de recherche sur l’environnement et le développement (Cired) de 1987 à 2012. Il a étécoordinating lead author (auteur principal) de différents chapitres des rapports du GIEC entre 1995 et 2007 et lead author du rapport 1,5 °C. Il est notamment l’auteur, avec Emmanuel Combet, deFiscalité carbone et finance climat. Un contrat social pour notre temps (Les Petits Matins, 2017). Pour ces deux économistes, donner un prix à la tonne de CO2 émise, que ce soit en l’ajoutant au prix de vente des produits « carbonés », en taxant les émetteurs, ou en échangeant des « permis de polluer », est souvent présenté comme le meilleur moyen d’inciter les acteurs économiques – producteurs et consommateurs – à changer de comportement au bénéfice de la transition énergétique.
Le retrait de la taxe carbone face à la révolte des « gilets jaunes » montre que l’incitation ne coule pas de source…
Christian Gollier : La question posée est : combien est-on prêt à payer pour réduire les émissions de CO2 ? 50 euros la tonne ? 100 euros ? 500 euros ? Quelle est la valeur limite de l’effort que nous sommes prêts à consentir pour que les générations futures bénéficient d’un monde meilleur ? Les économistes font des modèles macroéconomiques pour déterminer un niveau de prix en fonction du coût des dommages potentiellement causés par le réchauffement climatique. A cette question normative s’ajoute une autre question : comment organiser la société pour que ce coût soit effectivement pris en compte ?
Jean-Charles Hourcade : Le prix du carbone a en effet une place centrale dans la transition, mais il faut élargir la notion d’effort à consentir. Car c’est aussi un effort pour réformer notre société au bénéfice des générations présentes, sinon tout sera bloqué. Nous devons définir un nouveau contrat social intégrant la question climatique ; l’utilisation de l’argent généré par le prix du carbone est un élément crucial de sa construction. (…)